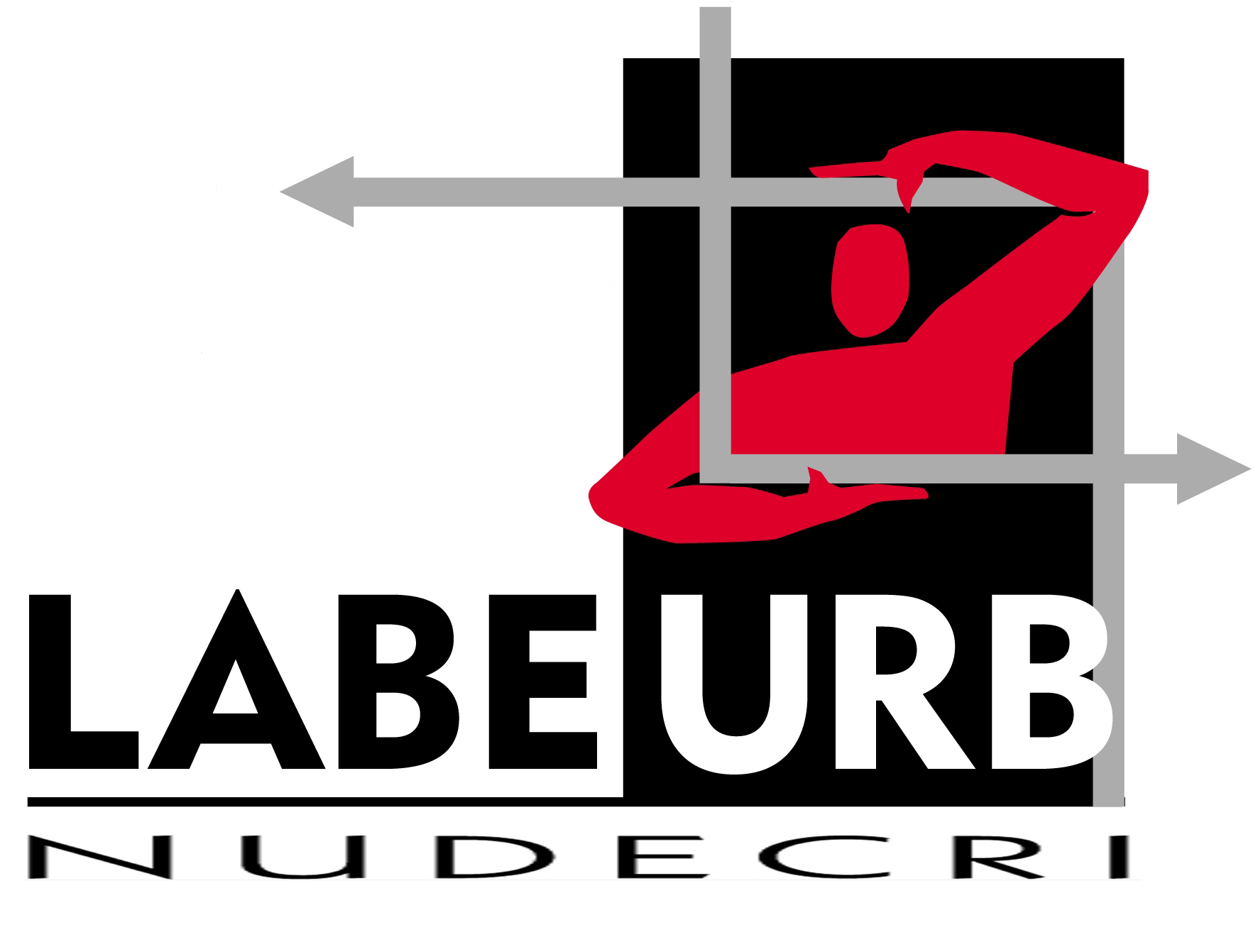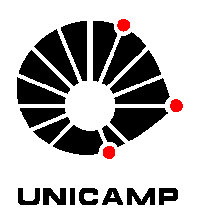Le capitalisme et la honte


David Bernard
Alexandre Levy
Le philosophe Giorgio Agamben proposait une distinction entrele fait «d'être moderne» et celui d’«être contemporain». Le premier est celui qui s'inscrit dans son temps, le second serait précisément celui qui ne s'y reconnaît pas et qui, à partir de ce décalage, peut saisir les modalités qui fondent ladite modernité. Le contemporain sera alors défini comme celui qui voit non pas les lumières de son époque, mais son obscurité. «Contemporain est celui qui, écrit Agamben, reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps»[1]. Etre contemporain peut ainsi s'entendre dans l'appréhension d'un certain réel qui se manifeste d'une époque.
Dans le droit fil de cette distinction, nous souhaiterions faire valoir comment Lacan aura pu voir l’une de ces obscurités. Il s’agit de cet affect singulier qu’il isole comme l’un des produits du discours de la modernité, nommé par lui honte de vivre. Toutefois, avant de venir à cet affect, et pour y venir, encore faut-il définir ce que commande ce discours, c’est à dire quelle est l’intention de ce discours[2]. C’est pourquoi nous débuterons par l’extrait d’une conférence donnée en 1973 à Milan, où Lacan précise ce que le discours capitaliste veut commander, ou plutôt exploiter: «L’exploitation du désir, c’est la grande invention du discours capitaliste (…) Qu’on soit arrivé à industrialiser le désir, enfin… on ne pouvait rien faire de mieux pour que les gens se tiennent un peu tranquilles, hein? Et d’ailleurs on a obtenu le résultat»[3]. Ainsi, le discours capitaliste assoit son pouvoir en gouvernant, en exploitant le désir, ce qui aura alors pour effet de contraindre les corps, de les rendre dociles, de les faire se tenir… tranquilles. Et le tout, en silence. Il ajoute en effet: ce pouvoir est «beaucoup plus fort qu’on ne le croit». Il est donc un pouvoir silencieux, qui parvient sans en avoir l’air, à asseoir chacun. En termes politiques, permettre à chacun de consommer est donc une façon d’acheter la paix sociale.
Le pouvoir du slogan
Le discours capitaliste est donc un discours qui commande. Raison pour laquelle Lacan le comparera au discours du maître, tout en remarquant: «c'est exactement le même truc [que le discours du maître], simplement c'est mieux foutu, ça fonctionne mieux, vous êtes plus couillonnés»[4].
Mais pourquoi ? Pour l’éclaircir, disons d’abord la fausse promesse de ce discours. Le discours de la science alliée au capitalisme promet aux désirs l’objet qui leur manque. Il repose repose tout entier sur une exploitation acharnée du désir, en nous attachant particulièrement à l'horizon d'une jouissance mythique, toujours renouvelée. Ainsi, les objets de la consommation forment des jouissances possibles, potentielles. Et il suffit de l'annoncer comme telle, par l'entremise du slogan publicitaire – ces signifiants publicitaires qui fonctionnent efficacement à la mesure même de leur affinité avec les signifiants maîtres de l'inconscient: insistance, musicalité, rythme et répétition– pour produire une jouissance, sans doute la seule qui finisse par s'éprouver, une jouissance par procuration, jouissance toujours manquée, en référence à une jouissance mythique. Sur ce point, notons d’ailleurs que l'expression utilisée par Lacan, ponctuant cette assertion, «être couillonné», s'entend précisément dans cette économie de la jouissance phallique : il y a conjonction entre une promesse d'une jouissance toute, absolue, un «je vais te combler» adressé à l'usager, et son envers, relevant du vœu de mort, réduisant la subjectivité de l'usager à son être objectal, son être de déchet, un «je t'ai bien eu». Ainsi, un démenti du manque réside là, et qui s'institue dans ce qui peut apparaître comme un principe directeur, une injonction recouvrant la loi du marché, celle de satisfaire le client, ou l'usager : «Satisfait ou remboursé !», telle peut être la formule – qui est également un ordre – qui anticipe tout écart possible à l'accomplissement de la promesse capitaliste, promesse d'une complétude qui relève pourtant d'un acte de foi. Cette formule résonne comme semblant d'une croisade moderne, via l'impératif et l'empire de la satisfaction.
Une autre formule, qui est une trouvaille, vient comme paradigme de cette exploitation du désir: «J'en ai rêvé, Sony l'a fait !». Slogan que nous pouvions lire et entendre en France il y a quelques années de cela et où, soulignons-le, le manque est posé d'emblée par le «j'en ai rêvé». Seulement ici, le rêve n'est plus que le pâle et ridicule témoignage du manque que la marque Sony s'engage à créer, combler et satisfaire, venant réaliser alors la complétude qui faisait auparavant défaut pour le sujet. L'usage du démenti est là patent, et dorénavant généralisé.
De ce point de vue, l'analyse de Guy Debord, dans son écrit «La société du spectacle», apparaît comme l'une des plus pertinentes, notamment lorsqu'elle prolonge les développements de Karl Marx en 1867 sur le fétichisme de la marchandise[5], désignant la marchandise comme support du lien social entre les Hommes, venant se substituer à toute autre forme de lien[6]. Aussi, Guy Debord conceptualise le spectacle comme extension de cette notion. Mais cet essai politique, œuvre majeure pourtant visionnaire de l'évolution de notre société de consommation, néo-libérale, maintenant mondialisée, reste dans une sorte d'impasse dans sa finalité particulière, si nous en restons à la stricte volonté de l'auteur, explicitée à la fin de son avertissement à la troisième édition de l'ouvrage, le 30 juin 1992: «Il faut lire ce livre en considérant qu'il a été sciemment écrit dans l'intention de nuire à la société spectaculaire»[7]. En effet, malgré l'exactitude de l'analyse et des prédictions quant aux processus et à l'économie du spectaculaire, en y démontrant la redoutable efficacité, l'intention de Guy Debord ne nous renvoie qu'à l'impuissance d'une lutte directe et frontale, à méconnaître les enjeux subjectifs qui alimentent et répondent à l'efficace du spectacle. L'impuissance se situe ici à ignorer la possibilité d'un premier renversement dialectique comme temps logique au niveau du sujet, s'insurgeant contre le monde, où, questionnant sa plainte en retour, il s'agirait alors d'ouvrir à la question de sa part prise dans cette entreprise, dans ce «désordre» du monde[8].
Ce qui se satisfait
Et en effet, la promesse du discours capitaliste s’épuiserait assez vite si le sujet n’y trouvait un bénéfice. Après avoir isolé les termes de cette promesse, il nous faut donc interroger les raisons pour lesquelles le sujet s’y laisse prendre. Certains critiques du capitalisme, dans le champ psychanalytique, s’accordent alors pour y voir les bénéfices d’une jouissance sans limite que procureraient les gadgets de la science. La position de Lacan est sur ce sujet toute autre, si ce n’est contraire. Certes, une jouissance du sujet se satisfait dans sa participation à ce discours, mais qui s’oppose à celle promise. Lacan qualifie en effet les gadgets de la science d’objets plus de jouir en toc, pour la raison qu’ils «trompent le plus-de-jouir»[9], n’offrant au sujet qu’une jouissance du manque, de type surmoïque, jouissance de la perte de jouissance. Les objets de consommation trompent le sujet moderne qui s’y laisse prendre en prétendant pallier sa perte de jouissance, alors qu’ils ne feront qu’entretenir le goût pour cette perte même, et sa répétition.
C’est là un des secrets de la réussite capitaliste. La jouissance est ailleurs que celle promise, et d’une autre nature. Elle consiste dans son ratage même, et dans les sacrifices imposés au sujet pour accéder à ce qui ne sera qu’une jouissance en toc. Pour le fonder cliniquement et en préciser ensuite les conséquences d’affect, il vaut d’articuler à ces analyses de Lacan celles du philosophe Günther Anders, dont l’œuvre est de plus en plus traduite et connue en France. Anders précise d’abord la logique de ce discours capitaliste, avec sa façon singulière, d’allure shadockienne, de tourner en boucle. Le mécanisme de notre monde industriel, montre t’il[10], consiste en effet à produire des produits qui, en tant que moyens de production, sont destinés à leur tour à produire des produits etc..., jusqu’à ce qu’une dernière machine finisse par cracher le produit final, le produit de consommation. A quoi s’ajoute alors une autre nécessité: pour que le mécanisme puisse se répéter, inlassablement, il faudra encore que l’acte de consommer soit lui-même un moyen de production. Il faudra donc que l’acte de consommer créée lui-même un autre besoin, d’où la machine trouvera ensuite à redémarrer, etc…
Attardons-nous alors en ce point où surgit l’acte de consommer. Anders en fait valoir la dimension impérative, à plusieurs égards. La première est bien celle que soulignait Lacan: l’objet produit doit gouverner nos désirs, et pour cela, créer par son offre une demande. C’est là la vocation de toute publicité, mieux nommée réclame[11]. Pour exemple, écrit le philosophe: «un texte imprimé sur mon sous-main (…) me recommande avec insistance, (…) m’ordonne donc, d’acquérir, à la place du stylo à bille qui me convient parfaitement, un autre stylo à bille dont on me promet qu’il «fonctionne aussi sous l’eau»: même si je ne ressens pas le moindre besoin d’écrire sous l’eau, je dois donc sacrifier mon stylo habituel au nouveau stylo»[12]. Il y a donc, véhiculé par la publicité, un impératif, et qui est double. Il faudra non seulement acquérir l’objet décrété manquant mais aussi, injonction moins aperçue, se débarrasser au plus vite de l’objet précédent. Soit, non seulement les choses sont remplaçables, mais elles doivent être remplacées. La production est toujours une production de déchets. Plus précis, le produit idéal est celui qui «est consumé en même temps qu’il est consommé»[13].
Nous retrouvons ici les termes même de Lacan: le discours capitaliste se consomme si bien que ça se consume. Soulignons alors ce que cela signifie pour les sujets d’aujourd’hui. Premièrement, il s’en déduit que l’impératif véhiculé par le discours publicitaire, lequel promettait un plus de gain, est en fait un impératif de liquidation. Anders en conclut: «Toute publicité est un appel à la destruction»[14]. C’est là le «commandement»[15], l’impératif camouflé, sourd, que porte toute réclame, autant que tout objet de consommation, d’essence jetable. En effet, l’industriel qui produit un nouvel objet, produit aussi son dégoût, nécessaire à ce que cet objet soit aussitôt has been, et qu’il doive être remplacé. L’obsolescence devient la norme, faisant des objets de consommation des objets anhistoriques[16], faits pour ne pas durer, échapper à l’usage. Autrement dit, en même temps qu’un produit P1 est vanté par la réclame, est produit un produit P2, destiné déjà à le supprimer[17]. Telle est la logique de ce discours qui «marche comme sur des roulettes», dit Lacan[18], de ce «manège qui tourne»[19], dira Anders.
Il faut alors en souligner avec le philosophe la conséquence, qui touche à l’absurde: le consommateur, qui croit posséder, n’est propriétaire de rien. Celui qui se paye le dernier cri, se paye en fait le manque de l’objet suivant. «Soif du manque à jouir», disait Lacan. Nous retombons en effet ici sur cette jouissance de type surmoïque, que Lacan dit à la racine du malaise dans la civilisation, et sur laquelle le discours capitaliste fonde son pouvoir. Nous en résumons dans ce cadre la logique: pour river les sujets à cette jouissance du manque à jouir, industrialiser, gouverner leur désir, en leur imposant les objets plus de jouir en toc lesquels, comble du comble, prétendent forclore le manque. Pour paradigme, ce slogan publicitaire que cite Anders, d’une compagnie de navigation vantant ainsi (et donc bien avant la trouvaille de Sony) les mérites de son nouveau bateau : «Avec notre technique, vous n’avez plus rien à espérer». Avant que d’ajouter «Tout est là, à votre disposition»[20].
Cette dernière formule, souligne Anders, dévoile alors le service type du discours capitaliste: la livraison à domicile, qui est en somme une autre façon d’asseoir chacun. A cette vie promise et prétendument servie, nous pourrions alors proposer, en y incluant un petit air de slogan publicitaire, le nom de: la-vie-facile[21]. La-vie-facile, soit celle que le discours capitaliste vend, d’où serait forclose la dimension du manque, disons même, le réel de la castration. Pensons pour autre exemple à la famille Ricorée. Rien ici qui ne ressemble à la matinée d’une famille ordinaire, a minima chargée du réel de son quotidien. Le rêve entretenu de l’homme d’aujourd’hui serait en cela une vie dont serait exclue la dimension du réel, autant dire de l’expérience.
La honte de l’usagé
A cela, s’oppose donc la vie en tant que le sujet y fait des expériences, à commencer par celle de ce discours capitaliste. Le sujet ne peut en effet sortir indemne de ce circuit de l'objet marchand, objet à la fois fétichisé, mais aussi objet «lathouse» comme l'évoque Lacan en inventant le terme. En effet, la notion de lathouse, avatar de l'objet phallique, mais également du gadget, vient mixer le léthé de l'aléthéia, c'est-à-dire littéralement «l'oubli», et l'ousia soit «la substance, l'essence». Ainsi la lathouse est à entendre comme l'objet dont la fonction est que son essence-même s'oublie, s'escamote, car fait pour foisonner et se renouveler dans le monde marchand[22], dans un manège gouverné par la science appliquée. Nous ne pouvons sortir indemne, disions-nous, du circuit des lathouses, car ce serait non seulement renoncer à ce formidable fantasme de réparation qu'est le rapport de service après-vente, des assurances et de l'échange standard, mais également renoncer à cette captivité sécurisante promise par ce discours.
Et c’est pourquoi il faut mesurer les effets de ce discours, parmi lesquels Lacan, dans son Séminaire L’Envers de la psychanalyse, situe la honte, et plus précisément, ce qu’il nomme la honte de vivre[23]. A le suivre, notons d’abord que cette forme nouvelle de honte prend corps dans une époque où règne la futilité. En témoigne une expression en usage dans les conversations d’alors, que Lacan rapporte : «Ca ne mérite pas la mort, dit-on à propos de n’importe quoi, pour ramener tout au futile»[24]. Lacan, attrapant cette expression, en fait donc un signe des temps. Sa thèse est en effet que le discours de la modernité, le discours du capitalisme associé au discours de la science, s’efforce d’élider la mort, c’est à dire l’impossible, c’est à dire le réel. D’où ce premier constat qu’il fait à son auditoire, sur la honte comme affect du réel: «Vous êtes servis, vous pouvez dire qu’il n’y a plus de honte.» Soit, plus de honte dans un discours qui réduit tout au futile, et voudrait rejeter le réel. Mais aussi bien, de la honte en retour de ce rejet premier. Raison pour laquelle Lacan ajoute l’instant d’après: la honte, « Vous en avez à revendre. Si vous ne le savez pas encore, faites une tranche, comme on dit. Cet air éventé qui est le vôtre, vous le verrez buter à chaque pas sur une honte de vivre gratinée»[25]. En cela, la honte de vivre est donc un rappel du corps parlant, un affect retour de cette volonté première, entretenue par le discours contemporain, d’élider l’impossible. Il y a un affect de honte propre à notre modernité par lequel se rappelle dans le lien social contemporain l’expérience du corps parlant que l’on voulait forclore.
Pour faire à présent valoir dans quelle mesure, revenons à Günter Anders, qui lui-aussi diagnostiqua une honte moderne. Il le fait en partant d’une anecdote : la visite qu’il rendit un jour dans un hôpital californien à un malade sans espoir de guérison, avec lequel il conversa en ces termes.
«A mon “How are you?”, il répondit par un geste qui ne semblait pas englober sa seule chambre mais l’humanité tout entière et me murmura quelque chose comme: «Nous ne savons pas grand chose, aucun de nous». Alors que je lui demandai ce qu’il voulait dire, il haussa d’abord les épaules, comme si la réponse allait de soi, puis il me répondit en me posant à son tour une question: «Peuvent-ils nous conserver?». (…) Il voulait dire: «Peuvent-ils nous mettre en conserve?» Je répondis par la négative. (…) «Et des hommes de rechange, ils n’en ont pas non plus?», dit-il ensuite. (…) « Des hommes de rechange?», demandai-je intrigué. «N’avons-nous pas des pièces de rechange pour tout?», poursuivit-il. Je compris enfin. Il avait forgé l’expression (…) hommes de rechange, sur le modèle de ampoule de rechange, ou de roue de secours. Il voulait dire: «Et des hommes de rechange, ils n’en ont pas en stock pour nous?» Une nouvelle ampoule électrique, pour ainsi dire, qu’il suffirait de visser à sa place lorsqu’il s’éteindrait. Ses dernières paroles furent: «N’est-ce pas une honte?»»[26]
Günter Anders fait alors de cette anecdote un paradigme. Selon lui, cet homme nous dit sa honte d’être un exemplaire unique, et périssable. Sa honte, non pas d’être remplaçable, mais d’être irremplaçable, a contrario des produits de marque que nous délivre en masse l’industrie moderne. En cela, cet homme nous révèle ainsi une «nouvelle variété de honte», que le philosophe nomme la «honte prométhéenne», et qu’il définit comme suit: «la honte qui s’empare de l’homme devant l’humiliante qualité des choses qu’il a lui-même fabriquées». Ici, le sujet serait affecté de ne pouvoir rejoindre la perfection des objets qu’il consomme et produit sans fin. Nous aurions ainsi, toujours selon Anders: la honte d’«être né», et non d’avoir été fabriqué. Mais aussi, la honte d’être mortel, quand le gadget, immortel parce que reproductible, sera devenu Le «modèle». Bref, la honte d’être obsolète.
Ainsi, au malaise dans la civilisation diagnostiqué par Freud, Anders répond : malaise de la singularité, avec en son centre, silencieuse, cette honte de ne pas être une chose. Il y a donc une «nouvelle variété de honte» : la honte du sujet de se réduire aux objets qu’il consomme, mais surtout, la honte d’y manquer. Et ce pour la raison qu’il y aura toujours, contre la qualité des choses, l’embarras, l’impureté, et la saleté du vivant, cette jouissance. Contre le rêve du tout-en-plastique, ce reste de terre[27] qui savait Freud, fait la marque du corps pulsionnel. Enfin, produit de la confrontation des deux, la honte pour le sujet, du plus particulier en soi, quand celui-ci manquera, par la force et la vertu de ses symptômes, à pouvoir s’aligner sur les gadgets surconsommés.
En un sens, cette honte moderne sera celle de l’usager. «L'usager», terme qui, notamment dans le secteur des prestations de services, en France, a pu remplacer par euphémisme les termes de «consommateur» ou de «client», vient non seulement questionner le rapport de vérité via l'usage des biens et des services, mais laisse entrevoir corrélativement un renversement possible et radical : l'usager est aussi celui qu'on use, c'est «l'usagé» au participe passé, celui dont on jouit en dernier lieu, et en même temps, dont on régule la jouissance par la même occasion avec notamment l'obsolescence programmée des produits consommés. Sa honte, telle que produite par le discours, sera donc non seulement de jouir du manque à jouir, via les objets obsolètes, mais celle de s’éprouver réduit à cet objet pour l’Autre. Obscolescence de l’homme, écrit Anders.
Faut-il alors s’en inquiéter? Pas sûr, quand la honte est au moins le signe que le sujet reste divisé par les prêt-à-jouir auxquels on l’enjoint. Lacan y revient dans sa conférence La troisième. Les gadgets de la science ne parviendront pas à opérer comme véritables objets cause de désir, mais ne seront que symptômes. «Les gadgets (…), demande t’il, gagneront-ils vraiment à la main? Arriverons-nous à devenir nous-mêmes animés vraiment par les gadgets? Cela me paraît peu probable, je dois le dire. Nous n’arriverons pas vraiment à faire que le gadget ne soit pas un symptôme.»[28] Voilà qui dès lors relativise le pouvoir des dits gadgets et laisse une place pour la psychanalyse, comme expérience. Une expérience qui justement, dira Freud, devra être vécue «à même son corps»[29]. Mais aussi, une expérience qui puisse offrir un autre usage de la honte. Soit, contre la honte du symptôme, aussi bien que contre l’espoir d’en être définitivement allégé, la possibilité de s’en servir. N’est-ce pas là un pari de la psychanalyse? Freud n’y aurait pas contrevenu, qui aura fait de l’association libre, la «promesse» de ne pas céder sur la honte, plutôt d’apprendre d’elle. En témoigne encore cette anecdote que rapporte Theodor Reik de sa courte analyse avec Freud. Lui confiant un jour qu’il avait «honte» de dire ce qu’il venait de penser, Freud lui avait répondu, d’une voix calme: «Soyez honteux, mais dites-le!»[30]. De quoi en conclure que la guérison, soit le fait de tempérer la souffrance du sujet, n’est pas la visée dernière de la psychanalyse. Mais que l’expérience analytique offre encore à qui le désire, au-delà de l’effet thérapeutique, d’apprendre de son symptôme. Autrement dit, contre un discours qui voudrait tenir ce symptôme pour quelque chose de honteux, de «méprisable» dès lors qu’il résiste aux mots d’ordre de la performance, en extraire tout au contraire, écrit Freud en 1914, «quelque chose de précieux pour sa vie ultérieure»[31].
Bibliographie
AGAMBEN G., Qu'est-ce qu'être contemporain ?, Paris, Rivages Poche, 2008.
ANDERS G., L’obsolescence de l’homme, Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, éd. de L’encyclopédie des nuisances / Ivrea, Paris, 2002.
ANDERS G., L’obsolescence de l’homme, T.II, Fario, Paris, 2011.
BERNARD D., Lacan et la honte, éd. du Champ lacanien, Paris, Juin 2011.
DEBORD G., La société du spectacle, Nrf, Gallimard, 1967.
FREUD S., Préface à Bourke G.J, Les rites scatologiques, PUF, Paris, 1981.
_______., Préface à Jeunes en souffrance, de August Aichhorn, éd. Champ social.
_______., «Remémoration, répétition, perlaboration», in Œuvres complètes V. XII, Puf, Paris, 2005.
LACAN J., Séminaire «L’insu que sait de l’une-bévue s’aile a mourre», inédit.
_______., «Excursus», Intervention dans une réunion organisée par la Scuola freudiana, à Milan, le 4 Février 1973, parue dans Lacan in Italia.
_______., Je parle aux murs (Le savoir du psychanalyste), Paris, Seuil, 2011.
_______., «Intervention sur le transfert», in Ecrits, Seuil, 1966.
_______., Le Séminaire Livre XVI, D’un Autre à l’autre, Seuil, Paris, 2006.
_______., Le séminaire livre XVII, L'envers de la psychanalyse, coll. Le champ freudien, Paris, Seuil, 1991.
_______., «La troisième», inédit.
MARX K., Le capital (1867)
Data de Recebimento: 20/05/2016
Data de Aprovação: 28/07/2016
[1] Agamben G., Qu'est-ce qu'être contemporain ?, Paris, Rivages Poche, 2008, p. 22.
[2] Lacan J., Séminaire «L’insu que sait de l’une-bévue s’aile a mourre», leçon du 19 Avril 1977, inédit.
[3] Lacan J., «Excursus», Intervention dans une réunion organisée par la Scuola freudiana, à Milan, le 4 Février 1973, parue dans Lacan in Italia.
[4] Lacan J., Le savoir du psychanalyste, entretiens à St Anne, séance du 2 décembre 1971, (inédit) et Lacan J., Je parle aux murs, Paris, Seuil, 2011, p. 66.
[5] Cf. thèse 36 et suivantes de l'ouvrage : Debord G., La société du spectacle, Nrf, Gallimard, 1967, p. 21.
[6] Marx K., Le capital (1867)
[7] Debord G., «Avertissement pour la troisième édition française», in La société du spectacle (1967), nrf, Gallimard, 1992, p. XII.
[8] Référence au texte de J. Lacan, «Intervention sur le transfert», in Ecrits, Seuil, 1966, p. 219.
[9] Lacan J., Le Séminaire Livre XVI, D’un Autre à l’autre, Seuil, Paris, 2006, p.103.
[10] Anders G., L’obsolescence de l’homme, T.II, Fario, Paris, 2011, p.16-17.
[11] Ibid., p.43
[12] Ibid, p.44
[13] Ibid, p.279
[14] Ibid, p.44
[15] Ibid, p.197
[16] Ibid, p.279
[17] Ibid, p.299
[18] Lacan J., “Du discours psychanalytique”, inédit.
[19] Anders G., L’obsolescence de l’homme, T.II, op. cit., p.48.
[20] Ibid, p.335
[21] Ibid, p.194.
[22] Lacan J., Le séminaire livre XVII, L'envers de la psychanalyse, coll. Le champ freudien, Paris, Seuil, 1991, p.189.
[23] Pour un commentaire plus détaillé de cette leçon, Cf. Bernard D., Lacan et la honte, éd. du Champ lacanien, Paris, Juin 2011.
[24] Lacan J., Le Séminaire Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Seuil, Paris, 1991, p.210.
[25] Ibid, p.211
[26] Anders G., L’obsolescence de l’homme, Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, éd. de L’encyclopédie des nuisances / Ivrea, Paris, 2002
[27] Freud S., Préface à Bourke G.J, Les rites scatologiques, PUF, Paris, 1981, pp.31-32.
[28] Lacan J., «La troisième», inédit.
[29] Freud S., Préface à Jeunes en souffrance, de August Aichhorn, éd. Champ social.
[30] Nous remercions notre collègue Jacques Adam d’avoir attiré notre attention sur ce témoignage de Reik
[31] Freud S., «Remémoration, répétition, perlaboration», in Œuvres complètes V. XII, Puf, Paris, 2005, p.192.
1
Exibindo 1 de 1